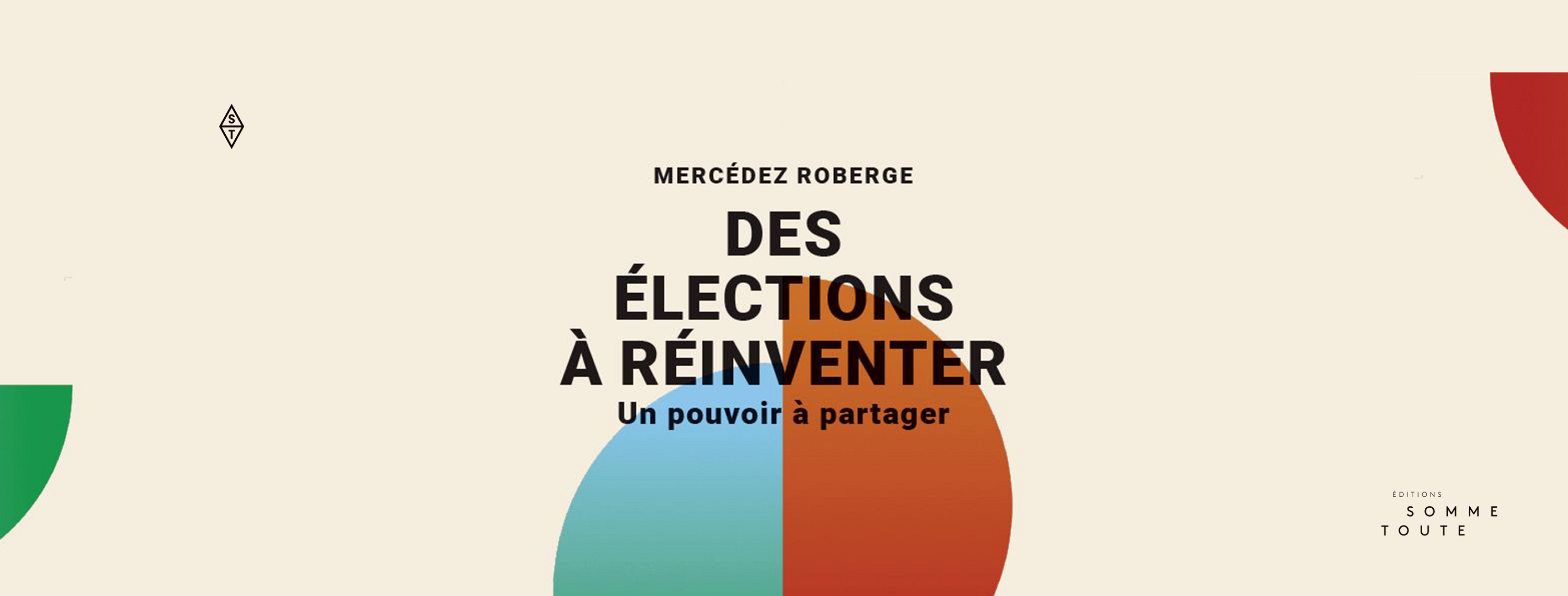Commentaire publié sous l’éditorial de Marie Vastel, dans Le Devoir du 26 juillet 2025 La CAQ, QS et l’éclatement de l’échiquier politique
Commentaire transmis (l’éditorial de Marie Vastel suit) : Quelques données illustrant les effets cumulatifs du système majoritaire sur l’expression du pluralisme politique et sur son développement
Non seulement le bipartisme n’existe plus et le système électoral n’est pas fait pour en tenir compte, ce dernier empêche la population de l’exprimer complètement. Le pouvoir serait exercé de manière très différente aujourd’hui si nous avions voté durant plusieurs élections sous un mode de scrutin permettant tout simplement que tous les votes comptent et que toutes les personnes comptent.
En plus de la monopolisation des sièges par la Coalition avenir Québec (72% des sièges pour 41% du vote), certaines conséquences des résultats de 2022 sont moins connues, tout comme la récurrence des pires défauts du système actuel
Rappelons-nous, par exemple, que cette surreprésentation a été vécue lors de 20 des 43 élections depuis 1867. De plus, celle-ci affecte cruellement les populations des régions : en 2022, 13 régions n’ont pas accès, ou presque, à des personnes élues de l’opposition, la CAQ y occupant de 80% à 100% des sièges, sans concordance avec les votes exprimés. Et cela n’est pas rare : depuis 2007 (6 élections), entre 8 et 13 régions ont subi pareille situation.
L’examen des écarts, un parti à la fois, entre les votes exprimés et la représentation obtenue ne suffit pas pour illustrer l’incapacité structurelle du mode de scrutin à tenir compte de la volonté populaire, il faut évaluer une élection dans son ensemble. Cela produit une note globale, soit son indice de distorsion (plus le chiffre est élevé, plus la distorsion est forte). En 2022, le cumul des diverses distorsions du système a produit un très mauvais indice de distorsion, soit 25,8 , soit 4 fois plus élevé que si un système proportionnel équitable avait été utilisé. Et ce taux démesuré n’est malheureusement pas exceptionnel, 2022 se classant au 10e rang des plus hauts indices de distorsion depuis 1867. La situation est d’autant plus grave, que les indices régionaux de distorsions varient de 19 à 51, soit des taux qui se répètent lors des élections des 15 années précédentes.
Parmi d’autres écarts, n’oublions pas que l’opposition officielle n’est pas formée par le parti occupant le 2e rang en nombre de votes, mais par celui arrivé 4e en pourcentages de votes (le Parti libéral du Québec). Il s’agit du 7e renversement des rôles à se produire depuis 1867.
Dans notre système plus de la moitié des votes sont systématiquement perdus parce qu’ils n’ont pas désigné la personne gagnante pour la circonscription. Aux élections de 2022, 2,1 millions de votes (53%) ont ainsi été évacués des résultats, soit le même taux que lors des 6 élections depuis 2007. L’analyse des résultats de chaque région trace un portrait pire encore, le taux national étant dépassé dans 12 régions, atteignant même 65,7% à Laval.
Toutes ces données, et bien d’autres encore, illustrent les effets cumulatifs du système majoritaire sur l’expression du pluralisme politique et sur son développement. Il est donc plus que temps de cautionner un système électoral qui est conçu pour fermer la porte de l’Assemblée nationale aux options politiques existantes dans la société, qu’elles nous plaisent individuellement ou non.
Mercédez Roberge, autrice de Élections québécoises de 2022 et précédentes : s’indigner et remplacer le système électoral (2024) et de Des élections à réinventer, un pouvoir à partager (2019 – Éditions Somme toute). Présidente du Mouvement démocratie nouvelle de 2003 à 2010.
Source des données : Élections québécoises de 2022 et précédentes : s’indigner et remplacer le système électoral, Mercédez Roberge, octobre 2024. www.mercedezroberge.ca
Éditorial de Marie Vastel du 26 juillet 2025
La CAQ, QS et l’éclatement de l’échiquier politique
Marie Vastel
Avec cette série, l’équipe éditoriale remonte la ligne du temps, du référendum de 1995 jusqu’à nos jours, et braque les projecteurs sur des Québécois dont le legs a durablement marqué notre paysage sociopolitique. Aujourd’hui : François Legault, le duo Françoise David et Amir Khadir, et l’avènement du multipartisme au Québec.
« Je ne souhaite pas être la saveur du mois », déclarait d’emblée François Legault en créant sa Coalition avenir Québec. « Nous ne serons pas des gérants d’estrade », affirmait Françoise David dès la fondation de Québec solidaire avec son co-porte-parole, Amir Khadir. Le pari de chacun était audacieux. Tous trois l’ont irréfutablement relevé, faisant mentir leurs détracteurs respectifs pour prendre pleinement leur place et faire éclater l’échiquier politique.
En l’espace de quelques années, l’hégémonie du bipartisme traditionnel s’est brisée au Québec, écartelée par l’hétérogénéité d’un électorat guidé non plus par l’unique question nationale, mais par la fragmentation de ses préoccupations citoyennes. Politiques économiques, inégalités sociales, urgence climatique et réflexions identitaires ont peu à peu occulté la prédominance de la question de l’avenir constitutionnel du Québec, essoufflée par un second revers référendaire. L’individualisme d’une époque se reflétant jusque dans ce morcellement démographique, géographique et générationnel de l’électorat.
Le débat constitutionnel a cédé sa place à de multiples débats de politique publique. Le réalignement de cet axe souverainiste-fédéraliste vers un axe gauche-droite, n’étant désormais plus accaparé par les deux seuls vieux partis, a ouvert le chemin à de nouvelles voies, que la CAQ et QS se sont empressés de défricher.
Ayant eu le flair de voir venir la mise en veilleuse du débat référendaire — ou l’arrivisme de renier ses convictions souverainistes, diraient certains de ses anciens collègues péquistes —, François Legault s’est saisi des jalons d’abord posés par l’Action démocratique du Québec (ADQ) pour consolider une nouvelle proposition autonomiste.
Là où l’ADQ s’était heurtée aux portes du gouvernement, en ne formant que momentanément l’opposition officielle en 2007, François Legault a sauté de nouveau dans l’arène en s’emparant de son positionnement ni fédéraliste ni souverainiste, en le recadrant ni de droite ni de gauche, pour étoffer cette troisième offre politique de sa propre expérience gouvernementale. Parvenant ainsi à ce que la CAQ franchisse quant à elle en 2018 la dernière ligne droite, pour obtenir la confiance populaire à peine sept ans après sa création. Une deuxième victoire électorale majoritaire d’affilée (inédite depuis 50 ans) est venue consacrer la place de la CAQ sur l’échiquier politique du Québec, ce qui a forcé le Parti québécois et le Parti libéral du Québec à des années d’introspection et de reconstruction toujours inachevées.
Un rebrassage du damier politique provoqué simultanément par l’arrivée sur le champ gauche souverainiste de Québec solidaire, né de la fusion d’Option citoyenne et de l’Union des forces progressistes. À peine l’ADQ venait-elle de réussir sa percée spectaculaire qu’un premier élu solidaire faisait à son tour son entrée à l’Assemblée nationale avec l’élection d’Amir Khadir en 2008, rejoint quatre ans plus tard par sa collègue Françoise David.
Les péquistes qui craignaient de voir QS grappiller le vote indépendantiste avaient vu juste : en l’espace de cinq scrutins, Québec solidaire comptait 10 députés et, surtout, canalisait l’appui de 15 % de l’électorat. Bien que cantonnés aux banquettes de l’opposition, ses élus n’ont plus à démontrer leur indéniable contribution au débat public, de même qu’au dispositif législatif.
À lire aussi
- Pas question de faire 25 années de plus pour le Mouvement démocratie nouvelle
- La course au porte-parolat de Québec solidaire sera lancée le 15 août
- Les libéraux de Rodriguez devancent la CAQ, selon un sondage
Certes, Québec solidaire traîne depuis ses débuts ces tiraillements entre pragmatisme politique et un brin d’idéalisme. La jeune troisième voie caquiste se heurte pour sa part, comme les deux vieux partis avant elle, à l’impasse de grandes réformes qui, en éducation comme en santé, tardent à aboutir, pendant que sa stratégie de petits gains auprès du gouvernement canadien en laisse certains sur leur faim. Or, que QS plafonne ou que la CAQ s’enlise, l’échiquier politique québécois ne se repliera pas dans un retour au bipartisme pour autant. Un cinquième joueur, le Parti conservateur du Québec, tente d’asseoir sa place à son tour, tandis que le PQ et le PLQ traînent encore de surcroît leurs propres défis.
Peu importent les couleurs du rebrassage électoral auquel procéderont les Québécois dans un an, tout indique que les tiers partis, quels qu’ils soient, récolteront toujours bien plus que le seuil de 20 % des voix fixé par les experts pour quantifier un système partisan ouvert.
Une nouvelle donne qui ne cadre résolument plus avec notre mode de scrutin uninominal à un tour, qui distord les résultats électoraux à répétition. Que quatre partis parviennent malgré tout à faire élire un contingent de députés — bien que non proportionnel aux appuis récoltés — témoigne de cette diversité idéologique désormais recherchée par un électorat qui mérite de voir ses choix dûment représentés.
Maintenant que tous les partis ont payé les frais de ce mode de scrutin, après avoir tour à tour pour la plupart refusé de le réformer dans le passé, voilà l’occasion pour leurs dirigeants de faire preuve de maturité politique en corrigeant, par respect pour leurs électeurs, ce déficit démocratique.
(Fin de l’éditorial de Marie Vastel, Le Devoir, le 26 juillet 2025))